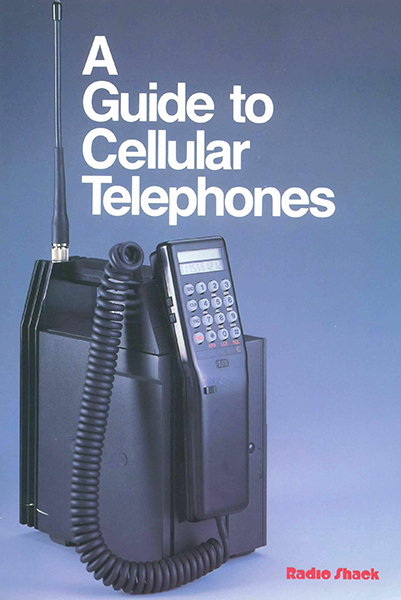Eté 1982, un an après avoir terminé mes études en arts plastiques, un ami illustrateur travaillant dans un studio de graphisme me contacte. «Stéphan, aimerais-tu apprendre à utiliser le airbrush, je suis débordé à mon boulot, j’ai besoin d’aide pour certains travaux.»
Eté 1982, un an après avoir terminé mes études en arts plastiques, un ami illustrateur travaillant dans un studio de graphisme me contacte. «Stéphan, aimerais-tu apprendre à utiliser le airbrush, je suis débordé à mon boulot, j’ai besoin d’aide pour certains travaux.»
Il m’apprit les rudiments pour commencer à maîtriser ce merveilleux médium et quelques mois plus tard, les petits contrats se mirent à arriver, principalement des retouches de photos. Il faut préciser qu’en 1982, les retoucheurs de photos étaient extrêmement rares à Québec et que l'aérographe était LE médium branché de l’époque. Mon père, qui travaillait comme conseiller en photogravure, me donna les noms de quelques contacts dans des agences de pub et studios de graphisme de Québec. Je me constituai ensuite un portfolio orienté vers du contenu publicitaire en suivant les conseils d’un des directeurs artistiques rencontrés et débutai une tournée des clients potentiels pour montrer mes travaux. Ce fut un succès immédiat, en avril 1983, ma carrière était lancée.
C’était un métier extrêmement exigeant au niveau de la qualité et du respect des délais. Il suffisait d’un ou deux mandats ratés pour perdre définitivement un client et se retrouver sur la «blacklist», comme on le disait à l’époque. On vivait constamment sur la corde raide. J’en ai vu quelques-uns, très talentueux, abandonner le métier suite à des revers. Il fallait donc livrer la marchandise et du travail top niveau à chaque fois, dans les délais, souvent pas plus que quelques jours pour réaliser une illustration, n’ayant aucunement droit à l’erreur ni aux retards. Je me souviens du trac que j’avais, à chaque nouvelle commande. Si je n’avais pas eu de talent et de «guts» et accepté de passer de nombreuses nuits blanches et week-ends pour compléter mes illustrations, je n’aurais tout simplement pas réussi dans le métier, point à la ligne.
Pour ceux que ça peut intéresser, voici quelques souvenirs et anecdotes sur ce qu’était la vie d’un illustrateur pigiste dans les années 1980. Il faut se rappeler qu’à cette époque, l’informatique commençait à peine à apparaître dans nos vies, et des logiciels tels que Photoshop faisaient encore partie de la science-fiction . Donc, pas d’Internet pour se documenter ou apprendre des trucs, pas de site Web pour s’afficher, ni de courriel ou FTP pour envoyer les illustrations et ni téléphone cellulaire , dont les premiers modèles, hors de prix, apparurent vers 1986.
En premier lieu, tout illustrateur(trice), graphiste ou photographe devait se constituer un portfolio, dans lequel il réunissait ses meilleures œuvres pour aller les présenter aux clients potentiels et tenter de les épater dans le but de décrocher des mandats. Ces rencontres étaient déterminantes. Aussi, une carte d’affaires de bonne qualité était de mise pour que les directeurs artistiques se souviennent de votre visite et puissent ensuite vous contacter.
Mon atelier de travail était installé de la façon suivante. Dans une grande pièce fermée avec des fenêtres, pour une bonne aération et avoir de la lumière naturelle, je disposais ma grande table à dessin près de la fenêtre et m’arrangeais pour que la lumière arrive de la gauche , étant droitier, pour éviter que ma main fasse de l’ombre lorsque je dessinais. Un bon éclairage constitué d’une bonne lampe à dessin à fluorescents de type blanc neutre et ultimement, un grand fluorescent de type «proof light» suspendu au plafond permettaient d’avoir une excellente précision au niveau des couleurs. J’évitais la lumière des ampoules incandescentes, trop jaune.
L’équipement nécessaire se constituait ainsi : des crayons à mine de plomb pour l’esquissage et le tracé final, des pinceaux de finition de qualité, des crayons de couleurs, de bonnes effaces blanches Staedler et des effaces spéciales pour enlever le pigment lors d’erreurs, un X-Acto à lames # 11 et un autre à tête pivotante, une bonne règle en métal, un grand rouleau de papier calque de qualité et un grand rouleau de film frisket. J’avais aussi besoin d’un masque respirateur pour me protéger lorsque je vaporisais à l’aérographe de grande surfaces avec du pigment. J’utilisais de grands cartons à illustration de type Frisk CS-10, parmi les seuls qui n’arrachaient pas lorsqu’on retirait les pochoirs. Je me servais aussi de pochoirs courbes mobiles que je découpais dans du carton mince.
Évidemment, je possédais quelques modèles d’aérographes. Mes préférés étaient un Iwata HP-SB et un Badger 150. J’avais aussi un Paasche à turbine, extrêmement précis, que j’utilisais plus rarement, acheté lors d’un Airbrush Seminar auquel j’avais assisté à Chicago en 1984, ils étaient alors hors de prix à Québec, plus de 400 dollars en argent de 1984. Un autre élément d’équipement important était le projecteur à dessin de type «Artograph» pour projeter et agrandir les esquisses avant de les retracer. Une table lumineuse complétait le tout.
Donc à mes débuts, je travaillais à partir d’un grand appartement situé dans le quartier Montcalm à Québec. J’avais réservé la plus grande chambre à coucher d’un vaste six et demi comme atelier. Pour en venir au sujet, dans la première moitié des années 1980, les compresseurs pour l’aérographe étaient soit trop petits et sans contrôles de pression ou soit trop gros – de type compresseurs d’atelier – beaucoup trop bruyants. La solution qu’on avait trouvé, moi et quelques copains illustrateurs, était de s’abonner à un fournisseur de bonbonnes d’air comprimé industrielles. Dans mes grosses périodes de production, on pouvait me livrer jusqu’à 2 bonbonnes par mois. Anecdote : Je me souviens de cette visite d’un pompier de la ville, en tournée de mon quartier pour vérifier si les détecteurs de fumée des appartements étaient en règle, qui sursauta lorsqu’il vit la bonbonne à côté de ma table à dessin. Interloqué, dans un moment de frayeur non feinte, il me demanda «Kessé ça!?!» Pour le rassurer, je dus lui expliquer que ce n’était que de l’air comprimé. Il fallut attendre la fin des années 1980 pour voir apparaître les premiers compresseurs silencieux munis d’un régulateur de pression, d’un petit réservoir de stockage d’air comprimé et d’un filtre à humidité.
La plupart du temps, une commande d’illustration se présentait de la façon suivante : je recevais un appel de l’agence de pub ou du studio de graphisme qui était intéressé à faire appel à mes services. On planifiait alors un rendez-vous pour un «briefing» (rencontre) avec le concepteur et/ou directeur artistique qui durait environ une demi-heure pour y discuter du style voulu, du budget et des délais de production. Je revenais de cette rencontre avec une maquette du client, souvent exécutée sur papier au feutre Pantone. De retour à mon atelier, il fallait ensuite que je cherche à me documenter s’il s’agissait d’une illustration réaliste et d’aller en prise de vues si nécessaire, en utilisant un Polaroid ou un appareil 35 mm et réussir à faire développer les épreuves dans un temps record pour pouvoir les utiliser. Dans certains cas, il était plus rapide d’aller à la bibliothèque municipale pour y photocopier – en noir et blanc – quelques photos trouvées dans des magazines ou pour emprunter quelques livres reliés au sujet voulu. La plupart des illustrateurs possédaient aussi une bonne collection de magazines de toutes sortes pouvant être utilisés comme références.
La première étape pour réaliser l’illustration débutait par une esquisse assez précise pour la faire approuver par le client, je l’envoyais par messagerie mais il pouvait arriver que je me déplace pour rencontrer les concepteurs et discuter des ajustements à apporter. Le temps alloué aux délais continuait à filer. Il était fréquent de n’avoir que quelques jours pour produire le final, ce qui impliquait de travailler le soir ou passer une nuit blanche pour pouvoir livrer à temps. Je passais ensuite à l’étape du tracé final, qu’il pouvait m’arriver de faire approuver une dernière fois avant la mise en couleurs.
Arrivait l’étape de la mise en couleurs du final. Je commençais par transférer mon tracé définitif que j’exécutais toujours sur un papier calque de la dimension de l’illustration finale. J’effectuais le transfert en collant une large bande de film frisket directement sur le calque qui était bien fixé à plat sur une table de travail, le tracé au plomb collait sur l’endos du film, m’évitant d’avoir à transférer le tracé directement sur le support de carton, risquant de le salir. Venait ensuite la découpe du frisket, longue et fastidieuse étape, créant ainsi des pochoirs, pour délimiter les zones à peindre à l’aérographe.
Venait enfin l’étape de la mise en couleurs finale. J’utilisais des encres acryliques pour aérographe, essentiellement les couleurs primaires CMJN, que je diluais légèrement pour avoir une texture laiteuse, plus fluide et moins concentrée. Je n’avais pas droit à l’erreur, le pigment appliqué sur le support de carton étant très difficile à effacer et à corriger, à cette époque, pas de «Ctrl- Z». Une de mes hantises était de trop mouiller le carton avec le pigment qui risquait de baver sous le frisket adjacent et d’arracher le pigment déjà appliqué en retirant le pochoir. Le truc était de repasser souvent avec de fines couches successives. Lorsque tous les pochoirs étaient retirés, suivait l’étape de la finition où je repassais sur les lignes avec un pinceau fin Winsor & Newton. Pour ajouter des rehauts de lumière, j’utilisais une efface abrasive ou une lame d’X-Acto pour retirer du pigment et retrouver le blanc du papier ou en ajouter à la gouache blanche, plus opaque que l’acrylique.
Le format habituel pour une affiche était de 18 par 24 pouces, maximum autorisé par les scanners à tambour rotatifs de type Linotype Hell Chromagraph utilisés par les photograveurs de l’époque pour générer les séparations de couleurs vers le CMJN. Vaporiser de telles surfaces à l’aérographe impliquait le port d’un masque pour filtrer la fine poussière de pigment ainsi qu’un bon système de ventilation. Pour les autres formats, je travaillais toujours au moins au double du format final pour que l’illustration puisse être réduite en vue de l’impression.
Suivait l’étape finale de la préparation des illustrations pour la livraison chez le client. Je couvrais l’illustration avec un grand papier calque et un papier kraft pour la protéger avant de glisser le tout dans un portfolio. La plupart du temps, je préférais livrer moi-même mes finaux plutôt que les envoyer par messagerie. Cette étape me donnait le trac à chaque fois; apprécieront-ils mon travail? Et ma hantise, quoique ça arrivait très rarement; y-aura-t-il des demandes de corrections? Ou la pire, extrêmement rare fort heureusement, qu’ils refusent carrément le travail pour le faire recommencer par quelqu’un d’autre. Quoi qu’il en soit, j’appréciais beaucoup ces visites chez mes clients, ça me permettait de constater leur réaction «live» et c’était très gratifiant et encourageant. Cette époque fait partie de mes beaux souvenirs. Ça faisait partie du plaisir de faire ce métier, disparu à notre époque d’envoi de finaux par FTP ou YouSendIt. Suis-je donc devenu nostalgique?
À mon humble avis, les illustrateurs ont vraiment perdu quelque chose avec l’arrivée de toutes ces nouvelles technologies, ce contact direct avec les clients, les sourires, le plaisir de se rencontrer. Pendant les dernières années de ma carrière, ça me manquait énormément. C’était devenu pour moi d’une grande lourdeur de travailler seul, virtuellement isolé devant mon ordi, à consulter les courriel et les réseaux sociaux, tous les jours, du matin au soir et attendre le feedback des clients après avoir envoyé des finaux via le Web. La soi-disant liberté du travailleur autonome, à la fin, je la vivais mal, toujours stressé par l’attente sans pouvoir trop m’éloigner de mon bureau. J’allais marcher en ville pour tenter de voir du monde, boire un café, toujours seul, tous mes clients travaillant dans leurs bureaux respectifs et les amis qui travaillaient aussi dans le jour.
En terminant, si j’ai un conseil à donner aux illustrateurs(trices), ne vous isolez pas. Associez-vous ou partagez des locaux avec d’autres pigistes ou trouvez-vous un emploi à plein temps en agence pour socialiser et travailler en équipe. Trop de solitude, pendant trop longtemps, ça mine, ça peut devenir malsain et déprimant à long terme.